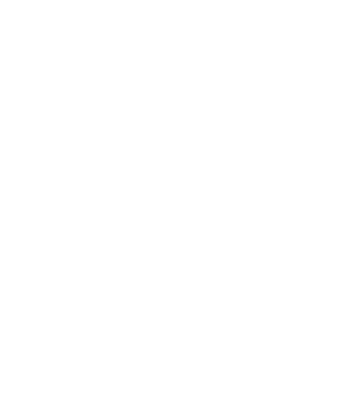Image 1 sur 6
Image 1 sur 6

 Image 2 sur 6
Image 2 sur 6

 Image 3 sur 6
Image 3 sur 6

 Image 4 sur 6
Image 4 sur 6

 Image 5 sur 6
Image 5 sur 6

 Image 6 sur 6
Image 6 sur 6







Mireille Havet | Journal 1919-1924
Aller droit à l'enfer par le chemin même qui le fait oublier
« Par amour de l’aventure, de l’ombre qui masque et de l’équivoque, j’ai préféré le mardi-gras où l’on pleure sous son masque, à tous les jours, et me voilà grimée pour la vie en pantin que rien ne casse, en fantoche de bois. Horreur ! Puisque tu es si consciente, me direz-vous, ô mes rares amis, pourquoi ne pas t’arrêter, ne pas reprendre souffle, pourquoi ? Parce qu’il est déjà trop tard, ou bien trop tôt, vous dirai-je, parce que je suis contaminée, parce que maintenant l’ennui me terrasse dès que je m’arrête, dès que je me tais, et que la solitude m’est un supplice bien mérité que ma faiblesse et ma lâcheté ne supportent plus ! Il faudrait qu’un être qui ne serait pas un maître d’école m’aime et me sauve par l’amour, par le voyage, par le travail compris et partagé, par l’argent ! Alors je renaîtrais à moi-même et le bon grain reprendrait ! Alors j’oublierais la parade du vice, le sadisme de la souffrance, la morbidité des larmes et des déceptions profondes et soutenues. Mais seule ! je ne peux et je ne veux pas. Je ne peux plus ! et je ne veux plus ! Le manque d’argent continuel fait que je préfère ce milieu louche où l’on nage, où l’or s’attrape comme les maladies, où l’on revend, prête et trafique jusqu’à l’âme. »
28 septembre 1919
Édition établie par Pierre Plateau, annotée par Dominique Tiry, Pierre Plateau & Claire Paulhan. Préface par Béatrice Leca, auteur de l’émission « Le cœur ouvert de Mireille Havet : Journal d'une enfant prodige » (France Culture, 4 septembre 2003).
Précisions
35 photos et fac-similés n. & b. Repères biographiques, Bibliographie, Index des noms cités.
Collection « Pour Mémoire ».
Édition originale parue le 1er avril 2005. Tirage à 3 000 exemplaires. Impression en caractères Plantin sur papier Minotaure ivoire 90 g., sous couverture à 2 rabats « Bleu de Sèvres », imprimée argent
13 x 21,7 cm. 544 pages
Isbn : 2-912222-21-3
Prix de vente public : 35 €
Aller droit à l'enfer par le chemin même qui le fait oublier
« Par amour de l’aventure, de l’ombre qui masque et de l’équivoque, j’ai préféré le mardi-gras où l’on pleure sous son masque, à tous les jours, et me voilà grimée pour la vie en pantin que rien ne casse, en fantoche de bois. Horreur ! Puisque tu es si consciente, me direz-vous, ô mes rares amis, pourquoi ne pas t’arrêter, ne pas reprendre souffle, pourquoi ? Parce qu’il est déjà trop tard, ou bien trop tôt, vous dirai-je, parce que je suis contaminée, parce que maintenant l’ennui me terrasse dès que je m’arrête, dès que je me tais, et que la solitude m’est un supplice bien mérité que ma faiblesse et ma lâcheté ne supportent plus ! Il faudrait qu’un être qui ne serait pas un maître d’école m’aime et me sauve par l’amour, par le voyage, par le travail compris et partagé, par l’argent ! Alors je renaîtrais à moi-même et le bon grain reprendrait ! Alors j’oublierais la parade du vice, le sadisme de la souffrance, la morbidité des larmes et des déceptions profondes et soutenues. Mais seule ! je ne peux et je ne veux pas. Je ne peux plus ! et je ne veux plus ! Le manque d’argent continuel fait que je préfère ce milieu louche où l’on nage, où l’or s’attrape comme les maladies, où l’on revend, prête et trafique jusqu’à l’âme. »
28 septembre 1919
Édition établie par Pierre Plateau, annotée par Dominique Tiry, Pierre Plateau & Claire Paulhan. Préface par Béatrice Leca, auteur de l’émission « Le cœur ouvert de Mireille Havet : Journal d'une enfant prodige » (France Culture, 4 septembre 2003).
Précisions
35 photos et fac-similés n. & b. Repères biographiques, Bibliographie, Index des noms cités.
Collection « Pour Mémoire ».
Édition originale parue le 1er avril 2005. Tirage à 3 000 exemplaires. Impression en caractères Plantin sur papier Minotaure ivoire 90 g., sous couverture à 2 rabats « Bleu de Sèvres », imprimée argent
13 x 21,7 cm. 544 pages
Isbn : 2-912222-21-3
Prix de vente public : 35 €