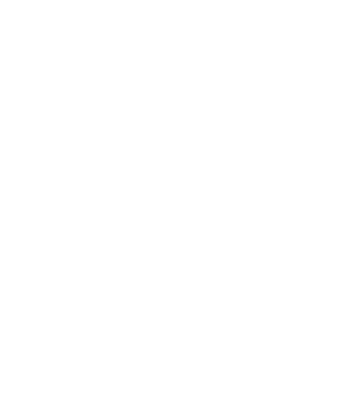Image 1 sur 2
Image 1 sur 2

 Image 2 sur 2
Image 2 sur 2



Paul Eluard & Jean Paulhan | Correspondance 1919-1944
Peut-on changer sans revenir à l’ancien ? changer en avant ?
Extraits de l’introduction de Claude-Pierre Pérez :
« Les noms d’Éluard et de Paulhan ne sont pas de ceux que l’on songe communément à rapprocher, ou à opposer. Non pas tant que l’un fut surréaliste et que l’autre s’est identifié à une revue qui eut des rapports souvent difficiles avec les amis de Breton. Mais comment faire le lien entre un poète lyrique et un essayiste sophistiqué, entre un « Pétrarque moderne » (ainsi que Paulhan définit lapidairement Éluard) et un maître ironiste, entre un communiste enthousiaste et un anti-communiste têtu, entre celui dont on se souvient comme d’un poète aimé de Gala, de Nusch et de quelques autres et celui en qui l’on voit d’abord un homme d’édition et de revues, une « éminence grise », un homme de pouvoir ? « Je connais peu de gens et j’ai peu d’autorité » écrit Éluard dans l’une des toutes premières lettres, en février 1919. Paulhan, à l’inverse, connaît déjà bien du monde ; d’où suit une demande : « Vous êtes plus nécessaire, vous serez plus utile que moi à notre tâche ». « Notre tâche », donc, comme ailleurs, deux années plus tard encore, « notre revue ». Et Paulhan, pareillement, dans l’une de ses réponses : « notre Proverbe ». Ils sont proches, sans doute, mais jusqu’où sont-ils ensemble ?
« Comprenez-vous donc, écrit Éluard dès février 1920, que je hais la N.R.F. et la littérature » ; la même année, Paulhan confie à Henri Pourrat : « J’ai une grande foi dans la NRF ». Cette foi, comme on sait, ne le quittera guère. L’appartenance des deux amis à deux groupes rivaux, l’un « dominé », l’autre « dominant » (et même, à partir de l’apparition de La Révolution surréaliste, en 1924, leur insertion dans deux revues rivales), entraîne divergences et conflits… Avant même le rapprochement entre surréalistes et communistes, qui s’engage en 1925, les difficultés ne manquent pas : il est vrai, sans doute, que Paulhan ne cite pas le nom d’Éluard dans les lettres où il s’en prend aux surréalistes ; et que s’il lui arrive de s’attaquer, dans sa correspondance, à la personne d’Aragon ou de Breton, on ne trouve rien de tel, sauf erreur, concernant Éluard. Mais enfin celui-ci appartient bel et bien à un groupe qui ne cesse guère de s’en prendre violemment et publiquement à La NRF, un groupe dont le chef, André Breton, a signé en février 1926 une première lettre d’injures à Paulhan, avant que la seconde, en octobre 1927, ne manque de les conduire jusqu’au duel. Éluard, cette fois-là, a été forcé de choisir. Et il a choisi Breton.
Le moment où Éluard reprend langue (prudemment, et par étapes) avec le directeur de La NRF, coïncide plus ou moins avec celui où il commence, à compter de mars 1936, à prendre avec Breton et ses fidèles ses distances : c’est au moment de la guerre d’Espagne en effet, qui est aussi celui des procès de Moscou, quand Breton publie ce que Paulhan appelle ses « manifestes contre Staline », que le poète des Mains libres commence à se laisser aspirer par le communisme officiel. Et cette rupture graduelle avec Breton est bel et bien contemporaine de son raccommodement personnel avec Paulhan (achevé en janvier 1937) et avec La NRF… On retrouve alors, au moins par moments, le ton de l’affection. Ainsi Éluard, en juin 1939, depuis la clinique où (une fois de plus) il séjourne : « Comme tu es gentil ! Tu es, tu as toujours été un des rares pour qui j’écris (Au début, tu étais le seul, avec Gala – aujourd’hui, dans mes moments d’exaltation, je les compte sur les doigts de ma main, par unités, et par milliards), c’est dire que je suis sensible à tes avis (mieux : à tes directives). Tu as toujours fait plus que m’admirer, tu t’es intéressé à mon “travail”, comme je m’intéressais au tien. / Comme je te voyais et t’écoutais avant-hier dans ma chambre et comme je te voyais et t’écoutais à Montboron (à Versailles) il y a 20 ans, tu n’as pas changé. »
Oui, curieuse amitié vraiment, et que les circonstances ont souvent contrariée, entre deux hommes dont l’affection semble toujours, hormis les premiers mois de leurs échanges, plus ou moins en attente d’une séparation et sous la perpétuelle menace d’une rupture. Au-delà de la formule conjuratoire d’Éluard : « il ne se peut pas que nous soyons séparés », qui date de 1925, on peut lire cette autre, de 1941 : « Ici, tout ce qui nous sépare nous rapprocherait », et cette troisième, qui est de Paulhan, en 1943 : « C’est là que je crains vaguement que nous ne nous séparions un jour ». Crainte bien fondée, on l’a vu, et singulière persistance. »
Édition établie, présentée et annotée par Odile Felgine – docteur ès-Lettres et Sciences politiques, biographe de Roger Caillois (Stock, 1994), de Victoria Ocampo (avec L. Ayerza de Castilho, Criterion, 1990), peintre, poète et romancière –, et par Claude-Pierre Pérez – professeur à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), écrivain et spécialiste de Paul Claudel (Le Visible et l’Invisible, pour une archéologie de la poétique claudélienne, 1998) et de Jean Paulhan (Le Clair et l’obscur, actes du colloque de Cerisy, Gallimard, 1999). Odile Felgine et Claude-Pierre Pérez ont déjà publié ensemble la Correspondance Roger Caillois - Jean Paulhan (Gallimard, 1992).
Précisions
19 fac similés et photographies n. & b. Annexes. Index des Noms et des Titres.
Édition originale : 22 décembre 2003. Collection « Correspondances de Jean Paulhan ».
Tirage à 1 150 ex. Impression en caractères Esprit, sur papier Minotaure ivoire 90 g., sous couverture rempliée bleue.
13 x 21, 5 cm 208 pages.
Isbn : 978-2-912222-20-6.
Prix de Vente public : 27, 00 €
Peut-on changer sans revenir à l’ancien ? changer en avant ?
Extraits de l’introduction de Claude-Pierre Pérez :
« Les noms d’Éluard et de Paulhan ne sont pas de ceux que l’on songe communément à rapprocher, ou à opposer. Non pas tant que l’un fut surréaliste et que l’autre s’est identifié à une revue qui eut des rapports souvent difficiles avec les amis de Breton. Mais comment faire le lien entre un poète lyrique et un essayiste sophistiqué, entre un « Pétrarque moderne » (ainsi que Paulhan définit lapidairement Éluard) et un maître ironiste, entre un communiste enthousiaste et un anti-communiste têtu, entre celui dont on se souvient comme d’un poète aimé de Gala, de Nusch et de quelques autres et celui en qui l’on voit d’abord un homme d’édition et de revues, une « éminence grise », un homme de pouvoir ? « Je connais peu de gens et j’ai peu d’autorité » écrit Éluard dans l’une des toutes premières lettres, en février 1919. Paulhan, à l’inverse, connaît déjà bien du monde ; d’où suit une demande : « Vous êtes plus nécessaire, vous serez plus utile que moi à notre tâche ». « Notre tâche », donc, comme ailleurs, deux années plus tard encore, « notre revue ». Et Paulhan, pareillement, dans l’une de ses réponses : « notre Proverbe ». Ils sont proches, sans doute, mais jusqu’où sont-ils ensemble ?
« Comprenez-vous donc, écrit Éluard dès février 1920, que je hais la N.R.F. et la littérature » ; la même année, Paulhan confie à Henri Pourrat : « J’ai une grande foi dans la NRF ». Cette foi, comme on sait, ne le quittera guère. L’appartenance des deux amis à deux groupes rivaux, l’un « dominé », l’autre « dominant » (et même, à partir de l’apparition de La Révolution surréaliste, en 1924, leur insertion dans deux revues rivales), entraîne divergences et conflits… Avant même le rapprochement entre surréalistes et communistes, qui s’engage en 1925, les difficultés ne manquent pas : il est vrai, sans doute, que Paulhan ne cite pas le nom d’Éluard dans les lettres où il s’en prend aux surréalistes ; et que s’il lui arrive de s’attaquer, dans sa correspondance, à la personne d’Aragon ou de Breton, on ne trouve rien de tel, sauf erreur, concernant Éluard. Mais enfin celui-ci appartient bel et bien à un groupe qui ne cesse guère de s’en prendre violemment et publiquement à La NRF, un groupe dont le chef, André Breton, a signé en février 1926 une première lettre d’injures à Paulhan, avant que la seconde, en octobre 1927, ne manque de les conduire jusqu’au duel. Éluard, cette fois-là, a été forcé de choisir. Et il a choisi Breton.
Le moment où Éluard reprend langue (prudemment, et par étapes) avec le directeur de La NRF, coïncide plus ou moins avec celui où il commence, à compter de mars 1936, à prendre avec Breton et ses fidèles ses distances : c’est au moment de la guerre d’Espagne en effet, qui est aussi celui des procès de Moscou, quand Breton publie ce que Paulhan appelle ses « manifestes contre Staline », que le poète des Mains libres commence à se laisser aspirer par le communisme officiel. Et cette rupture graduelle avec Breton est bel et bien contemporaine de son raccommodement personnel avec Paulhan (achevé en janvier 1937) et avec La NRF… On retrouve alors, au moins par moments, le ton de l’affection. Ainsi Éluard, en juin 1939, depuis la clinique où (une fois de plus) il séjourne : « Comme tu es gentil ! Tu es, tu as toujours été un des rares pour qui j’écris (Au début, tu étais le seul, avec Gala – aujourd’hui, dans mes moments d’exaltation, je les compte sur les doigts de ma main, par unités, et par milliards), c’est dire que je suis sensible à tes avis (mieux : à tes directives). Tu as toujours fait plus que m’admirer, tu t’es intéressé à mon “travail”, comme je m’intéressais au tien. / Comme je te voyais et t’écoutais avant-hier dans ma chambre et comme je te voyais et t’écoutais à Montboron (à Versailles) il y a 20 ans, tu n’as pas changé. »
Oui, curieuse amitié vraiment, et que les circonstances ont souvent contrariée, entre deux hommes dont l’affection semble toujours, hormis les premiers mois de leurs échanges, plus ou moins en attente d’une séparation et sous la perpétuelle menace d’une rupture. Au-delà de la formule conjuratoire d’Éluard : « il ne se peut pas que nous soyons séparés », qui date de 1925, on peut lire cette autre, de 1941 : « Ici, tout ce qui nous sépare nous rapprocherait », et cette troisième, qui est de Paulhan, en 1943 : « C’est là que je crains vaguement que nous ne nous séparions un jour ». Crainte bien fondée, on l’a vu, et singulière persistance. »
Édition établie, présentée et annotée par Odile Felgine – docteur ès-Lettres et Sciences politiques, biographe de Roger Caillois (Stock, 1994), de Victoria Ocampo (avec L. Ayerza de Castilho, Criterion, 1990), peintre, poète et romancière –, et par Claude-Pierre Pérez – professeur à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), écrivain et spécialiste de Paul Claudel (Le Visible et l’Invisible, pour une archéologie de la poétique claudélienne, 1998) et de Jean Paulhan (Le Clair et l’obscur, actes du colloque de Cerisy, Gallimard, 1999). Odile Felgine et Claude-Pierre Pérez ont déjà publié ensemble la Correspondance Roger Caillois - Jean Paulhan (Gallimard, 1992).
Précisions
19 fac similés et photographies n. & b. Annexes. Index des Noms et des Titres.
Édition originale : 22 décembre 2003. Collection « Correspondances de Jean Paulhan ».
Tirage à 1 150 ex. Impression en caractères Esprit, sur papier Minotaure ivoire 90 g., sous couverture rempliée bleue.
13 x 21, 5 cm 208 pages.
Isbn : 978-2-912222-20-6.
Prix de Vente public : 27, 00 €
Peut-on changer sans revenir à l’ancien ? changer en avant ?
Extraits de l’introduction de Claude-Pierre Pérez :
« Les noms d’Éluard et de Paulhan ne sont pas de ceux que l’on songe communément à rapprocher, ou à opposer. Non pas tant que l’un fut surréaliste et que l’autre s’est identifié à une revue qui eut des rapports souvent difficiles avec les amis de Breton. Mais comment faire le lien entre un poète lyrique et un essayiste sophistiqué, entre un « Pétrarque moderne » (ainsi que Paulhan définit lapidairement Éluard) et un maître ironiste, entre un communiste enthousiaste et un anti-communiste têtu, entre celui dont on se souvient comme d’un poète aimé de Gala, de Nusch et de quelques autres et celui en qui l’on voit d’abord un homme d’édition et de revues, une « éminence grise », un homme de pouvoir ? « Je connais peu de gens et j’ai peu d’autorité » écrit Éluard dans l’une des toutes premières lettres, en février 1919. Paulhan, à l’inverse, connaît déjà bien du monde ; d’où suit une demande : « Vous êtes plus nécessaire, vous serez plus utile que moi à notre tâche ». « Notre tâche », donc, comme ailleurs, deux années plus tard encore, « notre revue ». Et Paulhan, pareillement, dans l’une de ses réponses : « notre Proverbe ». Ils sont proches, sans doute, mais jusqu’où sont-ils ensemble ?
« Comprenez-vous donc, écrit Éluard dès février 1920, que je hais la N.R.F. et la littérature » ; la même année, Paulhan confie à Henri Pourrat : « J’ai une grande foi dans la NRF ». Cette foi, comme on sait, ne le quittera guère. L’appartenance des deux amis à deux groupes rivaux, l’un « dominé », l’autre « dominant » (et même, à partir de l’apparition de La Révolution surréaliste, en 1924, leur insertion dans deux revues rivales), entraîne divergences et conflits… Avant même le rapprochement entre surréalistes et communistes, qui s’engage en 1925, les difficultés ne manquent pas : il est vrai, sans doute, que Paulhan ne cite pas le nom d’Éluard dans les lettres où il s’en prend aux surréalistes ; et que s’il lui arrive de s’attaquer, dans sa correspondance, à la personne d’Aragon ou de Breton, on ne trouve rien de tel, sauf erreur, concernant Éluard. Mais enfin celui-ci appartient bel et bien à un groupe qui ne cesse guère de s’en prendre violemment et publiquement à La NRF, un groupe dont le chef, André Breton, a signé en février 1926 une première lettre d’injures à Paulhan, avant que la seconde, en octobre 1927, ne manque de les conduire jusqu’au duel. Éluard, cette fois-là, a été forcé de choisir. Et il a choisi Breton.
Le moment où Éluard reprend langue (prudemment, et par étapes) avec le directeur de La NRF, coïncide plus ou moins avec celui où il commence, à compter de mars 1936, à prendre avec Breton et ses fidèles ses distances : c’est au moment de la guerre d’Espagne en effet, qui est aussi celui des procès de Moscou, quand Breton publie ce que Paulhan appelle ses « manifestes contre Staline », que le poète des Mains libres commence à se laisser aspirer par le communisme officiel. Et cette rupture graduelle avec Breton est bel et bien contemporaine de son raccommodement personnel avec Paulhan (achevé en janvier 1937) et avec La NRF… On retrouve alors, au moins par moments, le ton de l’affection. Ainsi Éluard, en juin 1939, depuis la clinique où (une fois de plus) il séjourne : « Comme tu es gentil ! Tu es, tu as toujours été un des rares pour qui j’écris (Au début, tu étais le seul, avec Gala – aujourd’hui, dans mes moments d’exaltation, je les compte sur les doigts de ma main, par unités, et par milliards), c’est dire que je suis sensible à tes avis (mieux : à tes directives). Tu as toujours fait plus que m’admirer, tu t’es intéressé à mon “travail”, comme je m’intéressais au tien. / Comme je te voyais et t’écoutais avant-hier dans ma chambre et comme je te voyais et t’écoutais à Montboron (à Versailles) il y a 20 ans, tu n’as pas changé. »
Oui, curieuse amitié vraiment, et que les circonstances ont souvent contrariée, entre deux hommes dont l’affection semble toujours, hormis les premiers mois de leurs échanges, plus ou moins en attente d’une séparation et sous la perpétuelle menace d’une rupture. Au-delà de la formule conjuratoire d’Éluard : « il ne se peut pas que nous soyons séparés », qui date de 1925, on peut lire cette autre, de 1941 : « Ici, tout ce qui nous sépare nous rapprocherait », et cette troisième, qui est de Paulhan, en 1943 : « C’est là que je crains vaguement que nous ne nous séparions un jour ». Crainte bien fondée, on l’a vu, et singulière persistance. »
Édition établie, présentée et annotée par Odile Felgine – docteur ès-Lettres et Sciences politiques, biographe de Roger Caillois (Stock, 1994), de Victoria Ocampo (avec L. Ayerza de Castilho, Criterion, 1990), peintre, poète et romancière –, et par Claude-Pierre Pérez – professeur à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), écrivain et spécialiste de Paul Claudel (Le Visible et l’Invisible, pour une archéologie de la poétique claudélienne, 1998) et de Jean Paulhan (Le Clair et l’obscur, actes du colloque de Cerisy, Gallimard, 1999). Odile Felgine et Claude-Pierre Pérez ont déjà publié ensemble la Correspondance Roger Caillois - Jean Paulhan (Gallimard, 1992).
Précisions
19 fac similés et photographies n. & b. Annexes. Index des Noms et des Titres.
Édition originale : 22 décembre 2003. Collection « Correspondances de Jean Paulhan ».
Tirage à 1 150 ex. Impression en caractères Esprit, sur papier Minotaure ivoire 90 g., sous couverture rempliée bleue.
13 x 21, 5 cm 208 pages.
Isbn : 978-2-912222-20-6.
Prix de Vente public : 27, 00 €